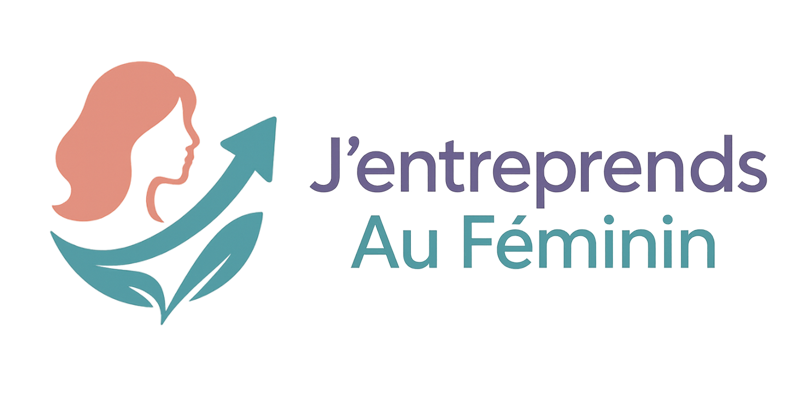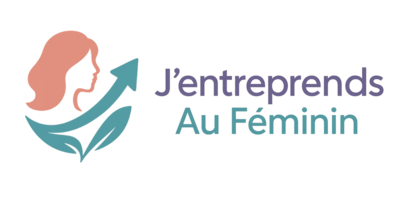Entre 2010 et 2022, le taux de croissance potentielle de l’économie française n’a jamais dépassé 1,4 % selon l’INSEE, alors qu’il atteignait le double dans les années 1970. Les estimations varient selon les institutions, mais convergent toutes vers un affaiblissement durable de cette dynamique.
L’écart avec les économies comparables s’est creusé, en partie sous l’effet de facteurs structurels persistants. Cette évolution questionne la capacité du pays à générer des gains de productivité et à soutenir l’emploi sur le long terme.
Comprendre la croissance potentielle : définition et enjeux pour l’économie française
La croissance potentielle n’est ni un slogan, ni une abstraction réservée aux économistes : elle représente le rythme maximal auquel une économie peut avancer sans déclencher d’inflation. Ce repère s’impose dans toutes les discussions sur la politique économique, balisant le champ des possibles pour les gouvernements et les parlementaires. Derrière ce concept, une idée concrète : le PIB potentiel, qui mesure la production maximale accessible à la France, à partir de ses ressources existantes et de son efficacité globale, sur le moyen terme.
Le calcul de cette croissance ne relève pas d’une opération élémentaire. Il faut croiser la comptabilité nationale avec l’étude de grands moteurs : démographie, productivité, stock de capital. Contrairement à la croissance observée d’une année sur l’autre, la croissance potentielle trace la trajectoire de fond, le cap auquel l’économie se heurte ou dont elle s’écarte. Lorsque la croissance effective dépasse ce seuil, le risque d’emballement des prix guette ; si elle reste en deçà, cela traduit une sous-utilisation des capacités nationales.
| Notion | Définition |
| PIB potentiel | Niveau de production soutenable sans tension sur les prix |
| Croissance potentielle | Variation annuelle possible du PIB potentiel |
Ce concept structure la plupart des choix publics : du cadrage budgétaire à l’orientation de la dette, en passant par la politique de l’emploi et la protection sociale. Entre 2010 et 2022, la France a vu son potentiel stagner sous 1,4 %. Une situation qui interroge l’équilibre de notre modèle économique comme celui de la solidarité nationale.
Quels sont les déterminants essentiels de la croissance potentielle ?
La machine de la croissance potentielle repose sur trois grands leviers. D’abord, le travail. Le volume de personnes actives, leur qualification, la part de la population qui occupe un emploi : tous ces paramètres jouent sur la capacité productive. Comme de nombreux pays européens, la France se heurte à un vieillissement démographique, qui limite la croissance de la population active et, par ricochet, le potentiel de production.
Le second levier, c’est le capital. Il ne s’agit pas d’un concept abstrait : derrière ce mot se cachent machines, usines, réseaux, mais aussi actifs immatériels, logiciels, données ou brevets. Le rythme auquel les entreprises investissent pour moderniser ou renouveler ces équipements, ou pour adopter de nouvelles technologies, influence directement la productivité du capital.
Enfin, le progrès technique sert de moteur aux gains de productivité. Il se matérialise par la capacité à innover, à diffuser des avancées technologiques et à revoir l’organisation du travail. Passer de la recherche à l’industrie, voilà le défi qui sépare les économies qui stagnent de celles qui avancent.
Voici les principaux facteurs qui composent la croissance potentielle :
- Travail : évolution démographique, taux d’emploi, niveau de formation
- Capital : investissement matériel et immatériel, renouvellement du parc existant
- Progrès technique : innovation, diffusion technologique, efficacité organisationnelle
La croissance potentielle résulte donc d’un dosage entre quantité, qualité et modernisation des facteurs travail et capital, le tout dynamisé par un progrès technique à la fois diffus et déterminant.
La France face à ses pairs : comparaison internationale et implications économiques
Le PIB potentiel français gravite aujourd’hui autour de 1 % par an, selon la plupart des organismes. Ce rythme, en retrait par rapport à l’Allemagne et bien derrière les États-Unis, met en lumière les difficultés à générer assez de richesses pour soutenir le modèle social et maintenir une dynamique de l’emploi.
Le diagnostic est clair : la France cumule plusieurs handicaps structurels. La participation au marché du travail reste faible, surtout parmi les seniors. Quant à l’investissement productif, il ne rattrape pas toujours le retard, malgré les avancées récentes dans le numérique et la transition écologique. Les gains de productivité, quant à eux, marquent le pas depuis le début des années 2000, creusant l’écart avec les économies anglo-saxonnes.
| Pays | Croissance potentielle (2023, %) |
|---|---|
| France | ≈ 1,0 |
| Allemagne | ≈ 1,2 |
| États-Unis | ≈ 1,8 |
L’architecture du secteur public, plus développée qu’ailleurs, agit également sur le rythme de croissance. Pour relever la barre, il faudra repenser l’accès à l’emploi pour les jeunes, encourager la montée en compétences et faciliter la mobilité professionnelle. Le prochain virage sera décisif : la France joue sa place dans la course économique internationale. Demain, la croissance potentielle sera-t-elle frein ou tremplin ? La réponse dépendra des choix faits aujourd’hui.