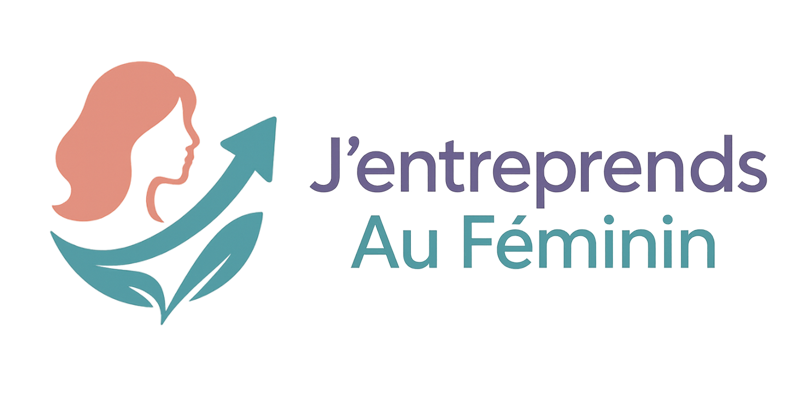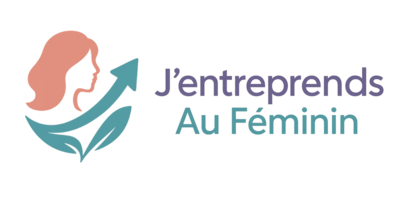La cession de bail, longtemps considérée comme un droit fondamental pour les locataires au Québec, change radicalement de visage : avec la loi 31, le propriétaire n’a plus à motiver son refus. Cette évolution vient bousculer un équilibre historique qui favorisait la fluidité du marché locatif.
Parallèlement, le texte législatif encadre plus strictement les conditions d’éviction et resserre les règles entourant la reprise de logement. Plusieurs procédures ont déjà été ajustées, entraînant de nouvelles responsabilités, tant du côté des propriétaires que des locataires.
Pourquoi la loi 31 marque un tournant pour le droit du logement au Québec
La loi 31, adoptée le 21 février 2024, rebat les cartes du secteur locatif québécois. Pilotée par France-Élaine Duranceau et portée par le gouvernement Legault, elle a été entérinée à l’Assemblée nationale du Québec dans un contexte de crise du logement sans précédent. Son objectif affiché : rééquilibrer les droits des locataires et des propriétaires, alors que la rareté des logements, la hausse des loyers et la difficulté à déménager frappent de plein fouet les ménages.
Le chantier est vaste. D’un côté, la loi serre la vis face aux évictions injustifiées et met en place un moratoire de trois ans sur les expulsions, un geste salué par plusieurs organismes sociaux. De l’autre, les propriétaires peuvent désormais refuser une cession de bail sans devoir se justifier, à condition de libérer le locataire, et la sous-location lucrative est désormais proscrite. Les compensations en cas d’éviction augmentent, jusqu’à 24 mois de loyer pour les locataires de longue date. Quant aux aînés vulnérables, ils bénéficient d’une protection renforcée face aux tentatives d’expulsion.
| Objectifs de la loi 31 | Effets notables |
|---|---|
|
Voici les principaux buts poursuivis par la loi 31 :
|
Plusieurs conséquences concrètes sont déjà observées :
|
D’autres changements notables s’invitent dans le débat : la vente partielle de HLM au secteur privé et de nouveaux leviers accordés à la Société d’habitation du Québec. Si certains y voient une modernisation, d’autres tirent la sonnette d’alarme, évoquant un recul des droits pour les locataires. La loi modifiant les dispositions législatives en matière d’habitation impose désormais ses règles, redessinant le paysage du logement au Québec, entre contraintes supplémentaires et nouvelles incitations.
Quelles sont les principales mesures et obligations introduites par la loi 31 ?
La loi 31 redéfinit en profondeur la relation entre propriétaires et locataires au Québec. Elle modifie à la fois le Code civil du Québec et la loi sur le Tribunal administratif du logement (TAL), avec des effets immédiats sur la gestion des baux et les possibilités de déménager.
Le premier grand changement concerne la cession de bail. Désormais, un propriétaire a la latitude de refuser la cession, sans avoir à fournir d’explication. En contrepartie, il doit libérer le locataire du bail, ce qui réduit la marge de manœuvre des locataires, en particulier dans un marché sous pression. Autre nouveauté : la sous-location à profit disparaît du paysage, mettant fin à la spéculation sur les loyers.
Les conditions d’indemnisation en cas d’éviction évoluent aussi. Le calcul s’ajuste : un mois de loyer pour chaque année d’occupation, avec au moins trois mois garantis et un maximum de vingt-quatre mois pour les locataires de longue date. Les personnes de plus de 70 ans, résidant depuis dix ans dans le même logement avec des ressources modestes, jouissent d’une protection supplémentaire contre l’éviction.
Pour les logements neufs, une règle s’ajoute : le propriétaire doit désormais indiquer le loyer maximal applicable durant les cinq premières années. Cette mesure vise à limiter les augmentations brutales de loyer. Depuis juin 2024, un moratoire général de trois ans freine les évictions, sauf exceptions prévues par la loi.
Le Tribunal administratif du logement voit son rôle s’étendre, notamment pour les litiges dépassant 100 000 dollars. Autre évolution : la représentation devant le TAL s’ouvre, permettant à toute personne mandatée ou à un avocat de défendre une partie.
Enfin, la loi attribue de nouveaux pouvoirs aux municipalités et à la Société d’habitation du Québec pour accélérer la construction de logements abordables, et permet, sous certaines conditions, la vente de HLM au secteur privé. Le cadre locatif québécois se transforme, imposant de nouvelles règles du jeu à tous les acteurs.
Propriétaires et locataires : comment s’adapter concrètement à ces nouvelles règles ?
La loi 31 redistribue les rôles dans le secteur locatif québécois. Désormais, chaque acteur doit composer avec des règles plus strictes, qui influent directement sur ses choix et sa gestion quotidienne.
Pour les propriétaires, refuser une cession de bail ne nécessite plus de justification, mais entraîne la libération immédiate du locataire. Cette nouvelle donne réduit la mobilité résidentielle, un enjeu d’autant plus sensible au cœur de la crise du logement.
Gérer un bail implique dorénavant davantage de rigueur. Lorsqu’il s’agit d’un logement neuf, le propriétaire doit mentionner le loyer maximal applicable pour les cinq premières années. À chaque étape, de l’envoi d’avis à la gestion des refus ou au calcul des indemnités, la documentation devient la règle. Les possibilités d’éviction, elles, se restreignent : depuis juin 2024, un moratoire de trois ans limite fortement toute tentative, sauf circonstances très spécifiques.
Pour les locataires, le contexte évolue aussi. Les indemnités d’éviction augmentent, renforçant leur position lors d’un conflit. Les aînés ayant résidé plus de dix ans dans leur logement, avec des revenus modestes, bénéficient d’une protection accrue. Un nouvel outil s’ajoute : la possibilité de réclamer des dommages punitifs si le logement est jugé impropre à l’habitation. Les différends se règlent devant le Tribunal administratif du logement (TAL), où les parties peuvent désormais se faire représenter plus aisément, que ce soit par une personne mandatée ou un avocat.
Les investisseurs et gestionnaires immobiliers, quant à eux, n’ont plus le luxe de l’improvisation. Chaque étape, fixation du loyer, administration des baux, gestion des litiges, impose une conformité rigoureuse, faute de quoi les sanctions financières peuvent tomber. Le marché du logement québécois ne laisse désormais rien au hasard.
Au Québec, l’équilibre locatif ne sera plus jamais le même. Les dés sont lancés, et chacun devra s’adapter, pied à pied, à ce nouveau terrain de jeu législatif. La prochaine décennie dira si cette refonte saura vraiment apaiser la tension sur le logement, ou si d’autres chantiers, plus profonds encore, devront s’ouvrir.